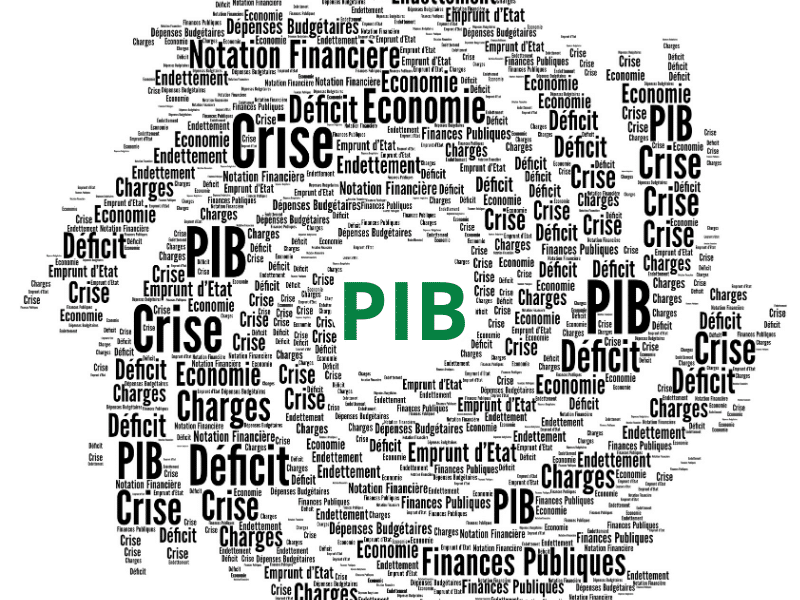
– X % de quoi ? Quelle mesure de l’activité pendant la crise, quelle(s) mesure(s) pour l’après-crise
La crise sanitaire a constitué un choc sans précédent pour l’activité économique, qu’on peut voir sous deux angles : des pertes de revenu et la crainte de destructions d’emplois pour le court et le moyen terme ; mais aussi la perspective d’un monde d’après dans lequel la croissance repartirait sous une forme plus équilibrée et plus durable, tel est du moins un espoir souvent exprimé. Comment ces deux points de vue du « pendant » et de « l’après » peuvent-ils faire évoluer le débat sur le principal outil de quantification de cette croissance, le produit intérieur brut, et plus généralement l’ensemble de la comptabilité nationale ? Si la crise donne un nouveau relief à certaines des critiques dont il est habituellement l’objet, elle donne en même temps de nouvelles raisons de le défendre. Elle invite à mieux préciser ce qu’il mesure, pour mieux voir dans quelles directions il doit être complété.
À ce jour, il est encore trop tôt pour dire avec certitude ce qu’aura été la baisse du PIB en phase de confinement et a fortiori ce qu’elle sera en moyenne sur l’ensemble de l’année. La première estimation du choc instantané l’évaluait à – 35 %. Appliqué à une durée de confinement d’environ deux mois, cela faisait 35 % de PIB en moins sur un sixième de l’année, donc un décrochement de presque 6 % pour le PIB total de l’année 2020, même dans l’hypothèse d’un retour à l’activité normale dès la sortie de confinement. Les chiffres plus récents suggèrent un choc un peu moins rude. Mais, en sens inverse, on sait que le retour à la normale ne pourra pas être immédiat. L’activité va certainement rester un bon moment en deçà de son niveau d’avant crise et pourrait ne le rejoindre que dans le courant du dernier trimestre, voire encore plus tard dans certains secteurs. Les prévisions actuelles tablent ainsi sur un décrochement total de l’ordre de 10 % sur l’année 2020, un chiffre sans antécédent depuis que le PIB est calculé.
Lorsque l’Insee a commencé à communiquer sur de tels chiffres, la question s’est posée du ton à adopter. La pertinence du PIB pour la conduite des politiques économiques et sociales est en permanence sur la sellette pour une partie importante de l’opinion et on commençait à voir monter le discours selon lequel la crise allait offrir un nouvel exemple de l’inadéquation de cet indicateur. L’urgence était plutôt à la gestion du choc sanitaire. Une insistance trop marquée sur la mesure de l’activité économique aurait pu paraître déplacée.
La comptabilité nationale bien dans son rôle
Les chiffres sont sortis néanmoins, avec les précautions qu’ils appelaient, et ils se sont finalement bien installés dans le débat public, avec moins de contestation qu’on ne pouvait le craindre. La raison vraisemblable est que, pour le coup, on est dans un cas de figure où la mission du PIB est la moins susceptible d’être mal comprise. Derrière son chiffre, il y a les revenus de la population, les risques de tomber au chômage ou de ne pas trouver d’emploi, les baisses de chiffres d’affaires et les risques de défaillance d’entreprises, les conséquences de tout cela pour les finances publiques. C’est justement pour aider les politiques économiques à gérer ces problèmes que les principaux concepts de la comptabilité nationale ont été forgés dans les décennies qui ont suivi la grande crise des années trente. La comptabilité nationale se trouve donc aujourd’hui pleinement dans son rôle, celui pour lequel elle a été conçue au départ. Si ce que dit le PIB peut échapper aujourd’hui à bon nombre de ses critiques habituelles, c’est parce que tout le monde comprend bien que, même transitoire, une baisse d’une telle ampleur aura sa traduction dans le contenu des porte-monnaie et/ou ce qu’ils permettront d’acheter, selon ce que sera l’évolution relative des grandeurs nominales et des prix.
Face aux critiques récurrentes dont le PIB est l’objet, la crise sanitaire a de plus offert un contre-exemple à la plus fondamentale d’entre elles, le reproche de constituer le seul critère d’orientation des politiques publiques, qui seraient toutes entières et indûment tendues vers sa seule maximisation. Les mois écoulés ont justement démontré que tel n’est pas le cas. On a su sacrifier des quantités considérables de ce PIB dans des circonstances extrêmes, ce qu’on a fait à juste titre. Les plus sceptiques objecteront sans doute que ceci n’aura été que l’exception confirmant la règle. Oui et non répondra-t-on. Oui en un sens, car il est vrai qu’on tergiverse bien davantage à sacrifier des points de PIB en réponse à d’autres besoins, et notamment l’urgence climatique. En même temps, sont-ce les comptables nationaux qui sont responsables du fait que la population doit ou souhaite continuer à prendre sa voiture et, pour celle qui en a les moyens, continuer à voyager loin en avion ? Et sont-ce les comptables nationaux qui sont responsables de comportements alimentaires qui sont eux aussi de gros contributeurs indirects aux émissions de gaz à effet de serre ? Évidemment non. Et il existe d’autres domaines dans lesquels les politiques économiques savaient déjà regarder ailleurs que dans la direction du PIB, ou tout du moins au-delà de son noyau dur que constitue l’activité marchande. Plus précisément, c’est pour éviter à un PIB trop réducteur de focaliser les décideurs sur cette seule dimension marchande que ce PIB « marchand » est élargi à la mesure de la production non marchande du secteur public, de sorte qu’un décideur qui ferait quand même le choix de maximiser le PIB ne le fasse pas au détriment de la fourniture de services que le marché n’est pas ou pas bien capable de rendre, notamment l’éducation et la santé pour tous.
Voilà donc autant d’arguments pour une utile défense du PIB en temps de crise. Mais une défense qui doit rester lucide et ouverte au débat, car la crise révèle malgré tout quelques zones de flou ou de tension sur les détails de cette mesure de l’activité, qu’il ne faut pas chercher à éluder. C’est ici qu’arrive la question du – x % de quoi exactement.
Quelques conventions qui peuvent interroger
Dès la sortie de la première évaluation à – 35 %, un certain nombre d’observateurs se sont en effet posé la question de comment la lire : le champ qu’elle recouvrait, le risque d’incohérences de la mesure sur les différents secteurs de ce champ. La baisse n’était-elle pas encore plus forte que cela sur le sous-champ du marchand ? Elle l’était de fait, de plutôt 50 % sur un champ qui excluait non seulement les services publics mais aussi le poste assez conventionnel des loyers imputés, ceux que les propriétaires occupants sont considérés comme se versant à eux-mêmes, comptés dans le PIB pour éviter qu’il ne conclue à des niveaux de vie plus faibles dans les pays à plus forts taux de propriétaire.
Deux mots pour commencer sur ce dernier poste, dont l’impact stabilisateur peut-être interrogé. Sa présence dans le PIB veut en effet dire que, même si absolument tout était à l’arrêt, la comptabilité nationale continuerait d’enregistrer environ 8 % de « production » s’autogénérant automatiquement. Ce paradoxe est un exemple des problèmes auxquels conduit le fait de demander à un indicateur unique de répondre à différents objectifs. On a besoin d’un PIB augmenté des loyers imputés si on veut comparer des niveaux de vie entre pays à pourcentages différents de propriétaires. Mais cela va bien moins de soi si la cible est la mesure de l’activité productive stricto sensu et de ses effets sur l’emploi. Une telle remarque vaut pour l’ensemble des loyers ceci-dit, car exclure les loyers imputés et conserver les loyers effectifs aurait faussé la comparaison du choc entre pays : l’activité mesurée dans les pays de locataires aurait conservé un élément d’inertie qu’on aurait fait disparaître de celle des pays de propriétaires.
Laissons néanmoins ce sujet de côté et concentrons-nous sur l’activité du secteur public. Comment mesure-t-on sa contribution au PIB ? Dans le secteur marchand, ce sont les prix de marché qui sont l’étalon des contributions au PIB, avec l’argument que, au moins à la marge, ils reflètent les utilités relatives des différents biens ou services pour le consommateur final. Après correction adéquate de l’inflation, les flux monétaires de transaction sont ainsi considérés comme une bonne approximation de ce qu’on appelle le volume total de la production, tous biens et services confondus. Dans le secteur public, il n’y a pas cette possibilité du recours aux prix de marché. La solution de remplacement est de s’appuyer sur les coûts de production, notamment les salaires.
On voit aussitôt les interrogations qui ont pu en découler pour le chiffrage de l’activité sous confinement. Dans le secteur privé, le recul des transactions donne bien une mesure du recul de l’activité. Du moins est-ce ainsi qu’elle sera mesurée de manière définitive une fois connus les comptes des entreprises. Dans le secteur public, l’essentiel des coûts sont des coûts salariaux. Ils ne sont pas affectés par le recul de l’activité car c’est en continuant à leur verser des salaires que l’État assure directement ses salariés contre le choc macroéconomique, tandis que cette assurance passe dans le privé par le chômage ou l’activité partielle. L’une comme l’autre de ces deux formes d’assurance seront financées in fine par le déficit public mais, dans le cas du secteur public, ce maintien de la rémunération pourrait apparaître à tort comme synonyme de constance de la production.
Comment échappe-t-on à une telle anomalie ? En réalité, le principe de mesurer l’activité du secteur public par les coûts de production ne vaut que pour l’activité en valeur. Pour le passage aux volumes, les comptes nationaux ont la possibilité de mobiliser d’autres informations. Il y a deux cas de figure : des sous-secteurs pour lesquels on dispose d’indicateurs directs, tels que le comptage des actes pour les soins de santé ou le nombre d’élèves pour l’éducation ; et les autres secteurs pour lesquels on retient l’hypothèse conventionnelle d’une production en volume proportionnelle aux intrants qui permettent de l’assurer, en premier lieu les effectifs occupés ou plus précisément leur temps de travail. C’est grâce à cela qu’on évite la situation embarrassante où les comptes mesureraient par construction une activité constante dans le public pendant qu’elle serait en chute libre dans le privé.
On voit néanmoins les problèmes de détail que peut poser l’application de ces règles.
Pour la santé, la comptabilité du nombre d’actes jouera à peu près son rôle, elle enregistrera à la fois les actes supplémentaires qu’a engendré l’épidémie, mais aussi en négatif les autres actes qui, en sens inverse, auront dû être reportés ou annulés. Le solde des deux aura un sens concret. En même temps, qu’est-ce exactement que comparer des volumes d’actes dans un contexte normal et celui d’une telle crise ? On tombe sur les limites des indicateurs de volume ou de service rendu. Il y existe certes des possibilités de réponse, par exemple la mesure des années de vie sauvées ajustées de leur qualité, mais évidemment trop complexes pour être mises en œuvre dans la pratique régulière des comptes.
Pour ce qui est du reste du secteur public hors éducation, les télétravailleurs et travailleurs sur site seront réputés avoir eu la même productivité qu’en temps normal. Seuls les agents en autorisation spéciale d’absence auront contribué à la baisse de l’activité. Ceci ne sera bien sûr qu’une approximation de ce qu’aura été la vraie chute d’activité, on ne sait pas dire comment la productivité du télétravail se compare à celle du travail sur site, mais il est difficile de faire mieux.
C’est dans le cas de l’éducation qu’on va déboucher sur le résultat qui peut interroger le plus. Ce qui a existé pendant le confinement est une situation dans laquelle des enseignants télétravailleurs ont assuré à distance la formation des élèves avec le concours de parents d’élèves assurant à domicile le suivi des devoirs et des leçons. Dans les comptes, aucun changement d’activité en volume ne sera enregistré : la mesurer par le nombre inchangé d’élèves aura le même effet que si on avait considéré tous les enseignants télétravailleurs comme ayant rendu un service en tous points identique à celui qu’ils auraient rendu dans les salles de classe. Or on se doute que tel n’a pas été le cas, non seulement en moyenne mais sans doute plus encore en dispersion, car l’école « à la maison » a certainement eu une efficacité très variable selon le milieu social.
Mais il y a aussi le fait que, si cette convention devait être confirmée dans la version finale des comptes et si telle devait en être la lecture, on contreviendrait par la même occasion à un des principes de base de la comptabilité nationale, le fait de ne pas compter dans le PIB les services auto-produits par les ménages – services de logement exceptés. Il est bien connu que préparer soi-même un repas ne fait pas partie du PIB, pas davantage que ne l’est, en temps ordinaire, le fait de devoir encadrer à la maison les devoirs des enfants. Or, dans le cas présent, faire comme s’il y avait eu continuité totale de la production d’enseignement viendrait déroger à ce principe, puisque revenant à inclure implicitement dans le PIB non marchand ce surcroît de production domestique grâce auquel le service global serait réputé avoir été maintenu. À l’opposé, et pour repasser au cas du marchand, le fait que du temps domestique ait été substitué à du travail de restaurateurs pour la préparation de nombreux repas restera bien compté comme baisse de production, même si, au total, on s’est nourri de manière à peu près équivalente.
Devoir additionner ce qui ne peut pas l’être
Cette incohérence peut paraître de détail, mais elle offre une nouvelle illustration des paradoxes que peut générer la notion formelle de « frontière de la production », celle qui distingue la production donnant lieu à rémunération monétaire et les autres formes de production. Cette notion de frontière de la production est à la base du calcul du PIB, avec de bons arguments, mais elle a été l’objet de pas mal de débats ces dernières années, suscités par la multiplication des services numériques gratuits, donc eux aussi réputés « non-produits » au sens de cette frontière. La crise donne de nouvelles illustration de l’inévitable porosité de cette frontière, un sujet sur lequel il n’est pas facile d’être pleinement à l’aise.
D’autant que les problèmes de mesure se posent tout autant à l’intérieur de cette frontière monétaire de la production, y compris dans son noyau dur marchand. Car que veut dire en effet de comparer l’agrégat « production » entre des temps normaux où on peut y comptabiliser des repas au restaurant ou des voyages en avion, et une période où toute l’attention s’est portée sur les biens de première nécessité et la production de soins de santé, de respirateurs et de masques, en notant au passage qu’une partie de ces derniers ont d’ailleurs été eux aussi produits à domicile, avec les moyens du bord et les conseils de fabrication fournis gratuitement sur le web, donc également non répertoriés dans le PIB ?
Force est de le reconnaître : ce genre de situation nous rappelle que ce n’est pas dans la construction d’un agrégat réputé mesurer le volume total de « la » production que les comptables nationaux peuvent se dire à leur meilleur. Mais personne d’autre ne peut prétendre l’être non plus, car il ne peut pas y avoir de définition indiscutable d’une telle notion de production. Construire un agrégat de la production, c’est vouloir additionner des nombres de repas au restaurant, des nombres de voitures sortant des chaînes de montage et des nombres d’actes médicaux assurés à l’hôpital ou en ville, ou a minima trouver une façon d’agréger leurs taux de croissance, deux questions qu’on sait sans réponse indiscutable par nature. On sait dénombrer séparément les voitures et les actes médicaux, et il est important de le faire. Mais il y a déjà beaucoup de conventions dans le fait d’additionner entre elles des voitures de différents modèles et d’additionner entre eux des actes médicaux de différentes natures. On en a encore plus et on voit même ce qu’il y a d’incongru à ensuite additionner ces deux catégories de production, tant elles sont irréductibles l’une à l’autre.
Ce que savent bien synthétiser les comptes est donc autre chose, ce sont les revenus générés par ces activités ou les coûts qu’elles occasionnent, c’est là qu’ils sont le plus incontestables car s’appuyant directement sur une observation aussi exhaustive que possible. Mieux vaut mettre l’accent sur le fait que c’est cela qu’on mesure bien, et ce sera d’autant plus pertinent que c’est ça qui, à la fin, va le plus intéresser le décideur et le citoyen en sortie de crise. Ce n’est pas de savoir combien de coupes de cheveux ou de plats du jour n’auront pas été « produits » de mi-mars à mi-mai qui sera le vrai sujet de mesure, encore moins de bien additionner ces deux manques-à-produire. La vraie question pour les coiffeurs ou les restaurateurs est celle des revenus qui leur ont ainsi échappé. On en revient à l’explication avancée plus haut pour expliquer que les chiffres de recul d’activité aient finalement été reçus comme plutôt pertinents. S’ils l’ont été, c’est pour ce qu’ils nous disent ou nous annoncent sur la façon dont auront été amputés ou pas tous ces revenus, ceux des entreprises comme ceux des ménages, et comment auront évolué les dépenses de l’État pour compenser ces chutes.
Des valeurs aux volumes : que faire dire aux indices de prix ?
Bien évidemment, insister sur cette dimension des flux monétaires et des revenus ne veut pas dire qu’on puisse se contenter de chiffrages nominaux en valeur. Ce qui compte est ensuite le pouvoir d’achat de ces revenus nominaux. C’est par ce biais que revient la question des volumes. Elle impose un détour par la mesure des prix, elle aussi chahutée en temps de crise. Elle l’a été à deux titres. D’abord un problème d’observation : certains prix ne sont plus observables ou ne sont plus observés, soit parce qu’il s’agit de biens ou de services qui ont temporairement cessé d’être fournis par le marché, soit parce que, même s’ils ont continué d’être fournis, le confinement a empêché les enquêteurs-prix de l’Insee d’aller les collecter sur les lieux de vente. Et ensuite un problème plus conceptuel de construction de l’indice : quel poids y donner à ces biens dont la consommation a fortement chuté ou est devenue totalement nulle ?
Les institutions qui sont en charge de la coordination statistique internationale ont répondu à ces interrogations par des directives précises :
- Collecter tout ce qui peut l’être, en recourant quand on le pouvait à d’autres canaux que le recueil sur place ;
- Lorsque des prix n’étaient pas du tout observables, supposer qu’ils auraient évolué comme ceux des biens les plus comparables ;
- Conserver les pondérations habituelles. Ce dernier point est celui qui peut le plus surprendre, mais il ne fait qu’étendre une règle usuelle de stabilité infra-annuelle des poids des différents types de biens.
En temps ordinaire les poids sont fixés à l’année sur la base des consommations annuelles moyennes ; on ne prend pas en compte le fait que, en cours d’année, il y a des biens saisonniers dont la consommation fluctue fortement d’un mois sur l’autre, ceci ajouterait un bruit inutile aux fluctuations de l’indice. Bien sûr on ne calcule pas non plus un indice de prix spécifique pour les dimanches au prétexte que beaucoup de magasins sont fermés ce jour-là et que les biens qu’ils vendent y sont donc temporairement inaccessibles, un tel calcul serait totalement dénué d’intérêt.
On voit la nécessité de telles directives aux instituts de statistique nationaux : il fallait garantir qu’ils allaient mesurer à peu près la même chose, pour éviter qu’on s’interroge à tort sur des divergences entre pays qui n’auraient été que de purs artefacts, c’est en soi très important. Ce qui est moins clair est de bien caractériser cette chose que tous les pays auront essayé de mesurer dans les mêmes termes. Car que penser en effet d’un indice ayant répercuté la baisse du prix du pétrole enregistrée sur la période selon le poids que la consommation d’essence a en temps ordinaire, alors même qu’une part de cette consommation était devenue temporairement impossible ou inutile.
Pour parer à cette critique à laquelle beaucoup ont pensé, il y a la voie du calcul d’indices complémentaires, comme l’a fait l’Insee, en proposant de mesurer l’évolution passée et présente du prix du sous-panier de biens qui ont continué à être consommés pendant le confinement. On constate qu’il a augmenté certes davantage que le panier habituel, mais pas non plus dans une proportion considérable. C’est une information importante. Il n’y a pas eu d’explosion de l’inflation sur les biens sur lesquels la consommation a été contrainte de se replier.
Ce qui reste moins clair va être de savoir quel indice il conviendra de retenir pour le calcul de ce qu’a été le pouvoir d’achat du revenu de mi-mars à mi-mai. Mais c’est cette fois-ci pour une raison de fond qui dépasse largement le problème de la seule mesure des prix stricto sensu. Mesurer le pouvoir d’achat en temps ordinaire c’est calculer comment un revenu nominal donné perd en capacité d’achat de biens sous le seul effet des augmentations de prix. Quel sens donner à ce concept lorsque les contraintes ne sont pas que de prix ? Que veut dire « pouvoir d’achat » quand il y a des « impossibilités » d’achat ?
Une solution théorique élégante à ce problème serait d’essayer de traduire ces impossibilités d’achat dans le langage des prix, en faisant appel à la notion de prix dit « de réserve », qui est le prix au-dessus duquel la consommation d’un bien s’annule spontanément, les consommateurs préférant s’en passer que d’y consacrer des sommes rédhibitoires. Une bonne mesure des prix qui déboucherait sur la bonne mesure de niveau de vie serait ainsi de faire comme si les prix des biens « interdits » étaient temporairement repassés au-dessus de leurs prix de réserve. Séduisante, la solution apparaît cependant très formelle et difficilement implémentable en pratique.
Ce qui nous tirera mieux d’affaire en matière de mesure du niveau de vie sera plutôt le caractère temporaire de l’épisode du confinement. On aura certes vécu plusieurs semaines comme si les prix de ces biens les avaient rendus temporairement inabordables. Mais il s’agit en bonne partie de biens dont l’achat était reportable dans le temps, les sommes qui y auraient été consacrées en temps normal ont donc été épargnées. La vraie question va être celle de la capacité d’achat de cette épargne en sortie de crise, pour des biens qui seront de nouveau disponibles avec des prix qui seront à nouveau mesurables.
Mesurer la croissance de l’après-crise
En matière de prix, on peut ainsi dire que le mieux sera de considérer la période de confinement comme une période définitivement atypique au cours de laquelle les compteurs auront perdu une partie de leur sens habituel, et laisser la mesure reprendre son cours normal une fois rétabli le fonctionnement normal de l’économie. Mais à quel point cette normalité sera-t-elle comparable à l’ancienne ? Si changement il y a, d’autres questions de mesure risquent-elles de surgir ? Beaucoup de sujets sont sur la table : nécessité de maintenir durablement des mesures de protection sanitaire ; relocalisation de certaines productions jugées trop stratégiques pour être laissées exposées aux aléas des circuits d’échange internationaux ; relance de l’activité par la promotion de dépenses plus vertes… La comptabilité nationale saura-t-elle bien rendre compte des évolutions de ce monde d’après ou se posera-t-il à nouveau des problèmes d’adaptation à un contexte qui aura changé ? Ici aussi la réponse doit combiner défense de l’existant et interrogations sur la façon de bien répondre aux questions qui vont nécessairement se poser.
Défense de l’existant tout d’abord. Si des mesures de protection sanitaire doivent être maintenues plus longtemps et font croître les coûts de production d’une façon qui est in fine répercutée au consommateur, on identifiera bien une baisse de pouvoir d’achat. Si la prise de conscience des risques que fait peser la fragmentation mondiale des chaînes de valeur conduit à rapatrier certaines productions avec pour effet de les renchérir, on aura la même répercussion sur les prix au consommateur que les comptes viendront également retracer. Quels que soient les arguments qui justifieront ces politiques, la comptabilité nationale sera dans son rôle si elle fait ressortir qu’elles ont un coût. Ce faisant, elle sera du reste en phase avec le ressenti de la population qui constatera elle aussi que, toutes choses égales par ailleurs, davantage de revenu nominal est nécessaire pour atteindre le même niveau de consommation finale.
Qu’en sera-t-il de la capacité à rendre compte du virage vers une économie plus verte, s’il se concrétise ? D’un certain point de vue, le sujet n’est pas très différent des deux précédents. Devoir procurer les mêmes services finaux en prenant également en charge les coûts de transition vers des modes de production moins destructeurs des ressources naturelles, c’est accepter au moins transitoirement des coûts de production plus élevés. Il est probable que la « relance verte » ne pourra pas être financée sans coût pour personne, et d’autant plus s’il faut ajouter à cela la prévention de nouveaux chocs sanitaires… Là aussi la comptabilité nationale sera dans son rôle si elle fait apparaître ces coûts dans sa mesure du pouvoir d’achat courant. À cet égard, il faut rappeler ce qu’ont été les dix années de l’après crise de 2008-2009 : un choc d’abord supporté par les entreprises et les finances publiques, avec un pouvoir d’achat des ménages qui avait réussi à ne perdre que peu de terrain dans les années d’immédiat après-crise mais qui a dû le compenser par une longue période de stagnation ; puis, lorsque cette période de stagnation a commencé à prendre fin, une détérioration de l’environnement économique en même temps qu’une tentative de pousser la fiscalité écologique, avec les suites que l’on connaît. Que les années à venir présentent une évolution similaire ou pas, disposer d’indicateurs qui permettront de suivre cette évolution et éventuellement d’en corriger les aspects les plus négatifs sera indispensable : ce n’est pas de moins mais d’au moins autant voire de davantage de comptabilité nationale et de sa désagrégation par catégories de ménages dont on aura besoin au cours d’une telle séquence.
Un effet « qualité de vie future » ?
Pour autant, on voudrait aussi que la bascule vers une croissance plus verte ne soit pas non plus vue que comme un coût, mais également comme productrice de quelque chose de meilleur. Comment faudra-t-il s’y prendre ?
Une piste possible serait de traiter le gain en qualité environnementale comme les autres gains en qualité qu’a l’habitude de gérer l’indice des prix : des biens certes plus chers, mais rendant un meilleur service en termes de préservation de l’environnement, donc des évolutions de coût et service rendu qui s’équilibreraient in fine.
Sur cette question des effets qualité, les statisticiens ont souvent été pris en tenaille ces derniers temps entre des commentateurs considérant qu’ils avaient tendance à les sous-estimer et d’autres leur reprochant au contraire de trop leur donner d’importance, conduisant à des critiques polaires de sous ou de surestimation de la hausse du niveau de vie. Concernant la croissance verte, il y a de bons arguments pour plutôt entendre la seconde critique. Gains en termes de qualité on espère qu’il y aura évidemment et on aura envie d’en tenir compte, mais ces gains seront essentiellement au profit de la collectivité et/ou des générations futures, sans gain ressenti en satisfaction courante par le consommateur individuel directement impacté par le coût de ces gains en qualité. Pas évident dans ces conditions que les consommateurs acceptent le message d’un niveau de vie qui continuerait à progresser après prise en compte de tels effets qualité, alors que leur ressenti de court terme serait uniquement la nécessité de dépenser plus pour le même service final apparent : la même température dans leur domicile, le même nombre de kilomètres parcourus pour se rendre à leur travail…
Ces interrogations sur la bonne façon de mesurer cette nouvelle forme de croissance recoupent des débats qui ont existé dès l’origine de la comptabilité nationale. Faut-il compter comme productions ou consommations toutes les dépenses dites « défensives » qui ne visent qu’à contrer des accroissements du mal-être, et plus précisément ici des accroissements en mal-être futurs, sans forcément générer de supplément de bien-être immédiat ? C’est bien parce qu’on les considère implicitement comme purement « défensifs » qu’on n’a aucune envie de traiter comme gains en qualité les surcoûts de protection sanitaire qui seront nécessaires tant que le virus continuera à circuler. La croissance « verte » pourrait avoir elle aussi un fort contenu en dépenses de ce type, tranchant radicalement avec la croissance rapide mais peu précautionneuse des trente glorieuses dont a bien rendu compte le PIB de l’époque ou plutôt son ancêtre le PNB, puisque tel était alors le nom de l’indicateur phare. Bien rendre compte de ce nouveau régime de croissance ne doit pas impliquer de mettre le PIB au rencart : on aura toujours besoin de ce qu’il peut nous dire sur les revenus et le pouvoir d’achat. Le problème sera de savoir bien l’associer à des indicateurs spécifiquement dédiés à quantifier les progrès de la soutenabilité environnementale. En gros, il faudra continuer à suivre comme on le fait le PIB et le niveau de vie des ménages, mais avec l’œil simultanément rivé sur la trajectoire des émissions de CO2 , la montée des températures ou les indicateurs de biodiversité. ■





